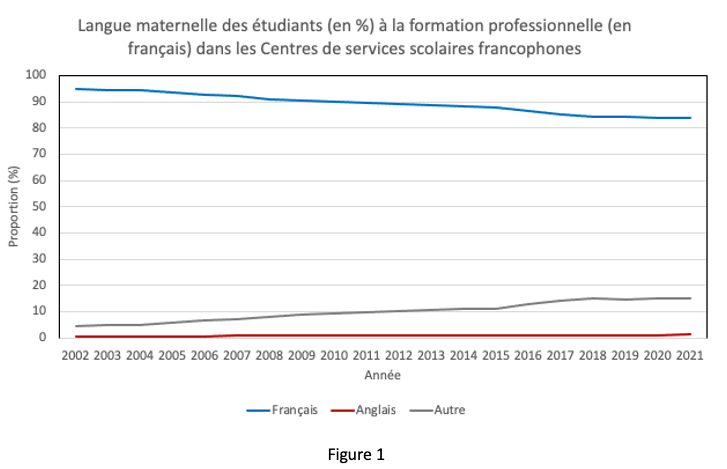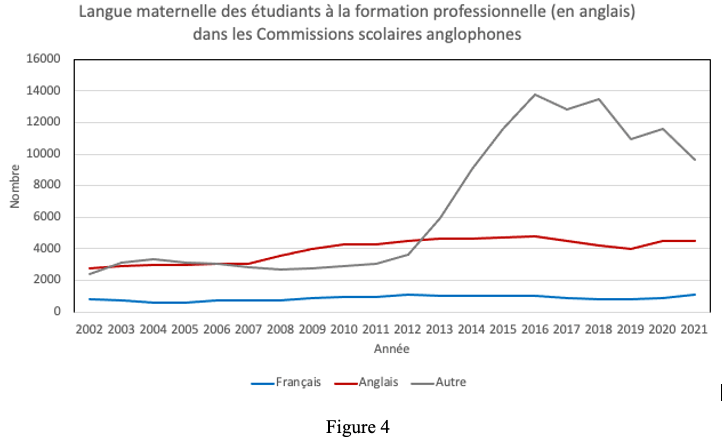En réponse à la volonté de la ministre Déry de cesser de subventionner les études en anglais des canadiens hors Québec qui viennent se scolariser à McGill et Concordia et qui anglicisent Montréal, les universités anglaises ont fait une « offre » au gouvernement : en échange de l’abandon de cette mesure, elles offriraient des cours de français, langue seconde, à une partie (40%) de leur clientèle.
Cette « offre », présentée comme une concession « historique », faite de bonne foi de la part des universités anglaise, est un piège.
Elle arrive premièrement beaucoup trop tard pour que l’on puisse présumer de la « bonne foi » de ces institutions. En effet, dans le volume 1 du rapport de la Commission d’enquête sur la situation de la langue française et sur les droits linguistiques au Québec, on peut lire la recommandation suivante : « Nous recommandons aux maisons d’enseignement secondaire et supérieur de langue anglaise du Québec d’accorder une plus grande importance qu’elles ne l’ont fait jusqu’ici à la culture franco-québécoise, afin de préparer leurs étudiants à mieux s’intégrer à la société québécoise. ». Cette recommandation date de … 1972.
Même si l’ajout de quelques cours de français est en soi une mesure intéressante, il est frivole de penser que cela va mener à une quelconque « francisation » (un terme valise imprécis dans ce contexte) dans un milieu aussi anglicisant que McGill ou Concordia. Ces cours vont mener à une certaine connaissance du français, qui est mieux que rien, certes, mais la simple connaissance d’une langue ne mène pas à son usage. L’Office québécois de la langue française, dans une série d’études parues en septembre et qui ont eu fort peu d’écho médiatique, vient de prouver ceci de façon définitive.
Dans ces études, l’on apprend que le fait d’avoir fait son diplôme postsecondaire en anglais multiplie par quatre les probabilités qu’un francophone ou allophone travaille ensuite en anglais au Québec (p.39). Qui plus est, le fait d’avoir fait son diplôme postsecondaire en anglais réduit de façon incroyable la préférence pour le français en tant que langue de travail (de 39,6 points pour les francophones, de 67 points pour les anglophones, et de 52 points pour les allophones) et augmente presque d’autant la préférence pour travailler en anglais. Les diplômés des institutions anglaises préfèrent généralement travailler en anglais même s’ils connaissent le français. Ce résultat est de très grande portée et invalide toutes les analyses fondées sur la seule connaissance du français comme critère d’évaluation de la dynamique linguistique.
Le fait d’avoir fait son diplôme postuniversitaire en anglais affecte également substantiellement la langue d’usage publique, les jeunes francophones diplômés en anglais au cégep ou à l’université utilisant plus l’anglais dans les commerces de proximité (18 fois plus, p. 44) que ceux diplômés en français, et ce, même s’ils ont manifestement une bonne connaissance du français! Et pour les allophones, les études en anglais au postsecondaire font basculer complètement la préférence de langue d’usage publique vers l’anglais.
La langue du diplôme postsecondaire change donc profondément l’univers culturel de référence de l’étudiant et fait de l’anglais la langue première d’une bonne partie de ceux qui effectuent leurs études postsecondaires en anglais. L’anglicisation via celles-ci est profonde.
La « francisation » dont font état les universités anglaises dans leur proposition sera, assumant très hypothétiquement qu’elle soit un succès, simplement le fait d’établir le français comme une langue seconde alors que la langue et la culture première ou de référence pour les étudiants restera-comme le démontre l’OQLF- l’anglais.
Depuis longtemps les opposants à l’extension des clauses scolaires de la loi 101 au postsecondaire affirment que l’inscription dans un cégep anglais n’est qu’une espèce de « bain linguistique » destiné à apprendre l’anglais et que le reste du parcours de vie d’un étudiant se fait en français une fois cette connaissance de l’anglais acquise. C’est parfaitement faux pour une proportion importante des diplômés. L’inscription dans un cégep (ou université) anglaise provoque, de façon durable, une hausse majeure de l’usage de l’anglais dans toutes les sphères de la vie et ce, peu importe la connaissance du français. L’usage domine la connaissance.